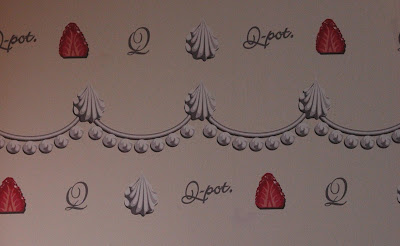Après Akihabara, voici Asakusa, où nous avons passé la majeure partie de ces deux derniers jours. Pour aller vite, Asakusa est considéré comme l’un des rares bastions tokyoïtes de la culture traditionnelle japonaise. Le quartier est légèrement excentré, son architecture plus sage, et on y trouve l’un des temples les plus emblématiques de la ville (dont je reparlerai bientôt).
Je commence la journée de jeudi avec deux photos qui vont sans doute devenir des rituels, à savoir la tenue du jour et le petit déjeuner.
 |
J’ai eu droit à un nombre assez incroyable de « Eeeeeeeeeh nekomimi » dans la rue,
preuve que le Japonais sait lui aussi être lourd. |
 |
Heureusement, le Japonais a inventé les Oréo en sticks, et ça, c’est assez formidable pour effacer le reste.
La boisson est un bubble-tea à la mangue. |
Nous avons commencé par aller visiter le Sensô-ji, le temple bouddhiste le plus vieux de le capitale, construit il y a plus de 1000 ans ! Il se trouve au milieu du parc d’Asakusa, entouré de plein de belles choses.
 |
| Comme de cette petite rivière qui coule en cascades. |
 |
| Avec des Magicarpes dedans ! |
Puis, après une petite flânerie dans le parc, on arrive devant la porte du temple. L’histoire de ce dernier, d’ailleurs, est assez amusante : au 7
e siècle de notre ère, un pêcheur trouve dans son filet une minuscule statue de Kannon, (en gros la boddhisattva de la miséricorde, l’une des plus révérées au Japon), en or, et alors qu’il en parle au chef de son village, ce dernier lui dit que c’est un miracle, et qu’il faut absolument construire un temple en son honneur. Et, bien sûr, on se saura jamais d’où venait cette petite statue.
Cette porte est nommée la porte de la Foudre, et on y trouve deux statues de chaque côté, la divinité du Vent à droite (Fûjin), et celle de la Foudre à gauche (Raijin).
Derrière cette porte, on trouve la reproduction d’une pagode construite par Tokugawa Iemitsu, le troisième shogun d’Edo (donc, pour transposer maladroitement, le troisième seigneur de l’ancienne Tôkyô). C’est la deuxième plus grande pagode du Japon.

En face de cette pagode, on trouve un grand chaudron d’encens. Faire venir les vapeurs d’encens à soi est un moyen de s’assurer une bonne santé. On trouve aussi des petits tiroirs dans lesquels se trouvent des prédictions, bonne ou mauvaise chance (les omikuji). Nous avons tenté le coup, payé nos petits papiers, et… Aïe aïe aïe ! Très mauvaise chance pour tous les deux, avec des messages aussi rassurants que « le malade ne guérira pas, les voyages seront mauvais (ouille), les mariages péricliteront, les entreprises échoueront… ». Autant vous dire que nous l’avions plutôt mauvaise, alors vite, nous avons noué nos papiers pour éloigner la mauvaise fortune, nous sommes allés nous purifier et j’ai été prier la boddhisattva pour qu’elle nous accorde un peu de sa miséricorde.
Du coup, dans le chaos causé par ces mauvaises nouvelles, je n’ai même pas de photo du temple à proprement parler !
A la sortie du temple, on trouve une longue allée bordée de petites boutiques de souvenirs, qui proposent des choses aussi variées que des takoyaki, des éventails, ou des posters de
Kimura Takuya (si vous n’avez jamais regardé
Mr. Brain, il faut y remédier !)
Nous avons décidé de nous promener un peu autour du parc d’Asakusa. On est tombés sur un sanctuaire avec des tanukis, mais les photos étaient interdites.
Si Akihabara est plutôt dépaysant, avec ses buildings colorés et lumineux, les petites rues traversées de fils électriques me transportent encore plus. Cela plus cette odeur si particulière que l’on n'avait jamais sentie avant, un mélange d’humidité, d’égouts et de sauce soja, nous font bien comprendre que l’on se trouve loin de notre France natale.
Après notre promenade, nous avons décidé d’aller voir d’un peu plus près la Tôkyô Sky Tree, la tour la plus haute du monde et la deuxième structure la plus haute du monde (la plus haute étant un gratte-ciel). Elle culmine à 634 mètres… et l’entrée est diablement chère (2000 yens par personne pour entrer, faire « oooh » et redescendre, ça ne nous tentait que moyennement). Mais rien que rester à l’extérieur vaut le détour !
 |
| « Et là, je t’impressionne, là ? » |
On s’est amusés à se donner le vertige (c’est un truc que j’aimais bien faire étant petite : vous vous mettez face à un mur, baissez la tête suffisamment longtemps pour que le sang y monte un peu, et vous la relevez très lentement. Vous aurez à coup sûr l’impression que le mur va vous tomber dessus. C’est assez impressionnant avec une tour de plus de 600 mètres !), et nous sommes allés manger.
 |
| Je sens que nous allons carburer assez longtemps aux onigiris tant c’est économique, pratique et bon. |
 |
Le Japon, l’endroit où tu trouves des produits de marque française que tu ne trouveras pas en France.
La tour Eiffel, un gage de qualité. |
Après le repas, nous avons été visiter un quartier assez excentré de la capitale, Shibamata, dont la rue principale, Taishakuten-sandô, est une rescapée du Japon typique des années 1940/1950, en grande partie parce qu’elle a beaucoup servi lors de tournages de films.
Une marchande vendait plusieurs types de kakikoori (de la glace pilée et du sirop, proche de nos granités), on en a pris un au matcha.
Au bout de la rue se trouve un temple, et le temple donne lui-même sur un petit jardin très agréable.
 |
| Temple. |
 |
| Jardin. |
 |
| Une grosse libellule ! J’adore les libellules. |
 |
| Miaou. |
 |
| Non mais quel poseur… |
Après cette promenade, nous sommes retournés vers Asakusa pour continuer notre visite des temples et sanctuaires du centre-est de Tôkyô. Mais ceux que nous voulions visiter ne se trouvaient pas sur notre carte, et nous cherchions désespérément sur un plan où aller, lorsqu’un Japonais qui parlait assez bien l’anglais est venu à notre rescousse. Il nous a proposé de nous accompagner, du moins c’est ce que nous avions cru comprendre, mais une fois arrivés il s’est même dévoué pour nous y servir de guide ! Nous avons passé près d’une heure en sa compagnie, et nous avons appris beaucoup de choses grâce à lui. Franchement, nous avons été plus que touchés par sa gentillesse et son dévouement envers deux inconnus !
 |
| L’entrée du temple. |
Ainsi, il nous a expliqué que la purification rituelle (main gauche, main droite, bouche) symbolise la purification du corps et de l’esprit. L’esprit doit se retrouver serein, vide de toute considération terrestre, pour pouvoir être plus réceptif à la divinité.
Pour prier dans un temple ou dans un sanctuaire, il faut lancer en guise d’offrande une pièce de cinq yens, soit
go en, qui se prononce de la même façon que
go-en, terme respectueux pour parler de réciprocité. La pièce de cinq yens est trouée en son milieu, et les Japonais considèrent que par ce trou se crée le lien spirituel entre la divinité et le prieur. Notre gentil guide nous a laissés seuls quelques minutes, au cas où nous souhaiterions prier.
Les Japonais ne voient aucun mal à ce que les étrangers viennent prier dans leurs temples et sanctuaires. On ne naît pas bouddhiste ou shintoïste (quoi qu'il existe une légère nuance pour le shinto, j’y viendrai), c’est avant tout une certaine conception du monde et de la spiritualité. La prière bouddhiste est plus abordée comme une recherche que comme une simple soumission, et cette recherche est accessible à tous sans distinction d’ethnie ou de culte.
Le shinto a ceci de particulier que les divinités japonaises n’existent que sur le sol japonais. Elles sont liées à des chemins, des montagnes, des rochers, un peu comme les divinités des fleuves à l’époque romaine. Il serait donc absurde de pratiquer le shinto en dehors du Japon ; en revanche, en naissant au Japon, on a tout intérêt à respecter le culte shinto pour s’assurer les bonnes grâces des divinités qui y résident. Par conséquent le touriste est tout aussi légitime que les Japonais pour prier ces divinités, car elles sont avant tout territoriales ! Cela explique également pourquoi les deux religions se côtoient si bien, et sont même souvent pratiquées ensemble, le bouddhisme se rapprochant plus d’une quête spirituelle et le shintoïsme d’un respect pour des esprits supérieurs.
 |
| Le sanctuaire. |
La prière shinto est beaucoup plus codifiée que la prière bouddhiste. Lors de la prière, il faut lancer la fameuse pièce de cinq yens, sonner une cloche pour signaler sa présence, s’incliner, taper deux fois dans ses mains pour attirer l’attention des divinités sur soi, s’incliner à nouveau, prier, s’incliner une dernière fois, et se retirer à reculons. Tout un rituel !
Après notre visite, notre guide nous a souhaité un bon séjour, et nous sommes partis chacun de notre côté. Je voulais essayer un café près de notre appartement, mauvaise idée ! On m’a servi ma pâtisserie avec de la crème, sauf qu’elle avait tourné à cause de la chaleur, et qu’on a dû rentrer en catastrophe tellement je me suis sentie mal. Malgré tout, l’Ohm a quand même tenu à repasser par le Sensô-ji pour retirer un papier de bonne fortune, et cette fois-ci fut la bonne ! Bonne chance pour les voyages, les malades qui guérissent, les couples qui perdurent, tout va pour le mieux !
 |
| Un immeuble sympa sur le trajet. |
Vendredi 26
Nous avons surtout dédié cette journée à la visite des musées du quartier.
 |
| En rose et en blanc, qui l’eût cru… |
 |
| Mochi et thé au jasmin, sans sucres ajoutés ! (ce qui est rare, ici !) |
Nous avons commencé par aller faire un tour au jardin Kiyosumi, qui date de 1721 et qui a plutôt bien survécu au terrible tremblement de terre des années 1920. Pas besoin de mots pour en parler, les images suffisent…
Nous y sommes allés très tôt le matin, nous étions seuls, et ce fut un délice. Un haïku de Bashô est gravé dans une pierre, dans un coin du jardin.
 |
| Furu-ike ya, kawaku tobikomu mizu no oto, soit : Un vieil étang, une grenouille plonge, le bruit de l’eau. |
Je serais complètement incapable d’apprécier le haïku dans sa langue originelle, mais ce que j’aime particulièrement dans celui-ci, c’est qu’il met en scène par une simple anecdote une ambiance poétique qui dépasse la barrière de la langue. On se représente le lac, majestueux, imperturbable, qu’une toute petite grenouille vient troubler l’espace d’un instant, avant que tout reprenne son cours… Et on est parti pour rêvasser un bon bout de temps.
 |
| Point de grenouilles par ici, mais des tortues, ça oui ! |
Nous sommes allés ensuite au Fukagawa Edo Museum, un musée qui a reconstitué le quartier de Fukagawa tout entier du temps d’Edo, qui s’étend du 17
e au 19
e siècle. Une véritable maquette à taille humaine, que nous avons traversée avec une adorable guide qui nous expliquait chaque détail avec beaucoup d’entrain, ce fut une visite très agréable et instructive ! Hélas mes photos sont toutes mauvaises, soit trop sombres soit trop floues, à une ou deux exceptions près…
 |
| Un des toits du quartier. |
 |
| Un coin où prendre le thé en attendant le bateau. |
Tôkyô est très pauvre en vestiges de cette période. Les maisons des quartiers populaires étant faites de bois et de paille de riz, elles n’ont pas résisté aux incendies, tremblements de terre et bombardements qui ont secoué l’histoire du Japon. Une reconstitution de cette envergure est donc vraiment appréciable pour mieux se représenter la ville quelques siècles auparavant.
Après la visite, nous sommes allés dans un autre musée dédié à l’histoire de Tôkyô, le Edo-Tôkyô Museum, lui aussi bardé de reconstitutions et de maquettes, qui côtoient cette fois-ci quelques vestiges, notamment des livres, des pièces et autres objets de la vie quotidienne.
 |
| Une maquette du Nihonbashi durant la période Edo. |
Pour nous accompagner dans notre visite, nous avons eu la chance d’avoir à nos côtés une bénévole anglophone qui nous a appris plein de choses. Deux heures et demie de visite guidée passionnante et gratuite, à quand la même chose en France ? (Mais peut-être suis-je mauvaise langue, et cela existe déjà ?)
Grâce à elle, nous avons essayé des instruments de musique utilisés lors des représentations de théâtre kabuki pour figurer la pluie, la neige, les spectres, le temps qui passe… C’était très amusant ! Ses explications très claires et détaillées m’ont permis de clarifier deux/trois choses qui étaient un peu obscures pour moi dans l’histoire du Japon, je garde donc un très bon souvenir du musée et de notre guide (qui portait un très joli yukata, de surcroît). De plus, pas mal d’objets de l’époque sont reconstitués pour qu’on puisse se figurer, par exemple, ce que cela faisait de voyager dans un palanquin, ou de porter deux seaux énormes remplis de, euh… fertilisant odorant d’origine humaine (tout se recyclait, à l’époque !).
Le musée est dans un bâtiment de 7 étages, son sommet étant exactement à la même hauteur que l’ancien château du shogun de la ville, qui n’existe plus. Il est donc possible d’avoir une belle vue de la ville à son sommet !
 |
| Enfin, belle. Une vue, quoi. |
Après ces visites, nous sommes tranquillement rentrés chez nous, en passant par les berges de la Sumida, l’un des cours d’eau qui traverse Tôkyô, mais je n’ai pas pris de belles photos. Trop de pollution, je pense que la vue est plus agréable le matin.
Pas de
haul cette fois-ci, je me réserve pour un gros achat que je devrais normalement faire aujourd’hui ! (Toujours finir sur un suspense insoutenable.)